Éric Chevillard
- ambrephilippefcg
- 1 août 2025
- 11 min de lecture
Dernière mise à jour : 29 août 2025
Fil, papier, ciseaux,
Éric Chevillard
D.S.A. : De l’édredon à l’accordéon, vous incitez à la rime. Le rire est physiologiquement explosion et résolution d’une tension. À certains égards, il est aussi sanction ; l’envisagez-vous comme possible résistance à des formes de domination ? É.C. : N’importe quoi ! En effet, quand je vois à quelles situations nous mènent la logique des sentiments, la mécanique des corps et les délibérations de la raison, dans quelles impasses sanglantes elles nous acculent, dans quel monde inhabitable elles nous précipitent, sans compter que, pendant que je vous parle, mon café refroidit, Éric-Emmanuel Schmitt écrit et la mort se rapproche, j’ai tendance à penser que n’importe quoi, n’importe quoi d’autre serait préférable, que mieux vaudrait nous laisser aller à la dérive, renoncer au contrôle, céder à la contingence, ne conserver que la bipédie et la syntaxe pour nous mouvoir, comme il suffit à la taupe d’un bon odorat et de griffes solides[1].

Présentation d'Éric Chevillard
« Éric Chevillard, né un 18 juin à la Roche-sur-Yon, anciennement Napoléon-Vendée, il ne s’endort pas pour autant sur ses lauriers puisqu’on le voit encore effectuer bravement ses premiers pas cours Cambronne, à Nantes. Il a deux ans lorsqu’il met un terme à sa carrière de héros national. Il brise alors son sabre sur son genou puis raconte à sa mère qu’il s’est écorché en tombant de cette balançoire et elle feint gentiment de le croire.
Ensuite, il écrit. Purs morceaux de délire selon certains, ses livres sont pourtant l’œuvre d’un logicien fanatique. L’humour est la conséquence imprévue de ses rigoureux travaux.
Il partage son temps entre la France (trente-neuf années) et le Mali (cinq semaines). Hier encore, un de ses biographes est mort d’ennui[2]. »
Cette notice autobiographique, dont le premier paragraphe illustre d’avance le principe d’écriture expliqué dans le deuxième, a été publiée en 2004. Huit ans plus tard, paraît L’auteur et moi (2012), où Éric Chevillard annote le texte du narrateur en livrant des faits de sa propre vie. Huit ans après (coïncidence ? attendons 2028), sort une autobiographie menée à toute vitesse, Monotobio (2020), où il défend ironiquement et pour mieux la contester la détermination du destin. Seule l’écriture, en les nouant d’un fil logique cocassement tendu, détermine la succession nécessaire de toutes sortes d’événements disparates, du plus menu bébé hérisson aperçu zigzagant sur l’herbe à la disparition de ses proches. Ces deux livres s’ajoutent aux Autofictifs qui réunissent chaque année les trois versets quotidiens du blog tenu par Éric Chevillard depuis 2007, blog d’humour et d’humeur, esquivant soigneusement la confession intime et pratiquant plus volontiers l’autodérision, et dont, curieusement, le recueil annuel change la perspective et la lecture. À ces écrits s’ajoutent des textes de fictions ou des essais, qui tous dessinent un univers singulier et immédiatement reconnaissable.
La plupart d’entre eux prennent des fragments de réel dans le fil rigoureusement déroulé de la logique, logique langagière des coïncidences phoniques entre les mots, des expressions proverbiales prises à la lettre, logique de situation (un hérisson sur la table de travail d’un écrivain), logique d’équivalence fonctionnelle (livre et tablette). Ils ligotent le tout jusqu’au rire dans les nœuds de la syntaxe : aphorismes imaginairement féconds (« La tablette numérique est au livre ce que le drone est au faucon » : grâce à Chevillard, les lecteurs que nous sommes ne prennent plus leurs tablettes numériques sans sentir le battement soyeux des pages absentes) ou paragraphes plus ou moins longs, vision délirante, entraînante, qu’il faut bien finir tout de même, et couper du ciseau de la ponctuation. Le texte prend alors, entre prose et poésie, la forme d’un réseau, d’un filet composé de fragments à peu près égaux, reliés par des répétitions ressemblant à des rimes ou aux vers des ritournelles. Une prose dont certains fragments s’impriment dans la mémoire comme des poèmes.
Le motif du fil revient souvent dans les écrits d’Éric Chevillard : fil de la canne à pêcher la truite lumière qui sera dégustée sur un lit d’amandes, fil de l’hameçon planté dans une lèvre, fil des marionnettes, fil d’or de Platon, fil de la Parque Lachésis en danger du ciseau d’Atropos, fil de l’araignée confinée dans la salle de bain du confinement (Sine die). La toile des livres tisse un monde personnel et universel, très réaliste et ouvrant pourtant des perspectives imaginaires au cœur de la vie la plus terre à terre. Aucun épanchement sentimental et sirupeux, mais des confidences au hasard d’une phrase (le cadeau rituel offert à l’anniversaire de la rencontre avec sa compagne de vie, la coupe du cordon ombilical de ses filles), des déclarations de haine comiques à l’égard des sans-gêne brutaux ou des écrivains à succès sans invention, des interrogations, des angoisses existentielles implicites mais lancinantes, une tendresse empathique et respectueuse envers les vivants et les éléments naturels, surtout s’ils sont faibles et menacés : les enfants, les vieillards et les animaux, auxquels la voix est donnée (mots d’Agathe et Suzie, ou encore le magnifique plaidoyer accusateur énoncé à l’Assemblée Nationale au nom de la collectivité animale décimée par les humains, où le « nous » est à la fois pourvu d’écailles, de plumes et de poils).
Loin des récits linéaires ou psychologiques, Chevillard invente une littérature qui se joue de la narration et des conventions. Cette forme d’écriture fragmentée et liée par une logique déconcertante, à la merci des déchirures définitives, a été narrativisée dans Ronce-Rose, une sorte de roman façon road movie, où la narration est presque entièrement faite par un personnage féminin alerte et raisonneur, qui raconte sa quête et ses errances. Une parole que nous sommes peu à peu amenés à mettre en doute et à tenter de déchiffrer, jusqu’au dernier chapitre qui énonce sèchement la solution, comme le constat d’un fait-divers. Équilibre délicatement maintenu entre comique et pathétique sous-jacent, débouchant sur une réflexion concernant un phénomène de société vu de l’intérieur.
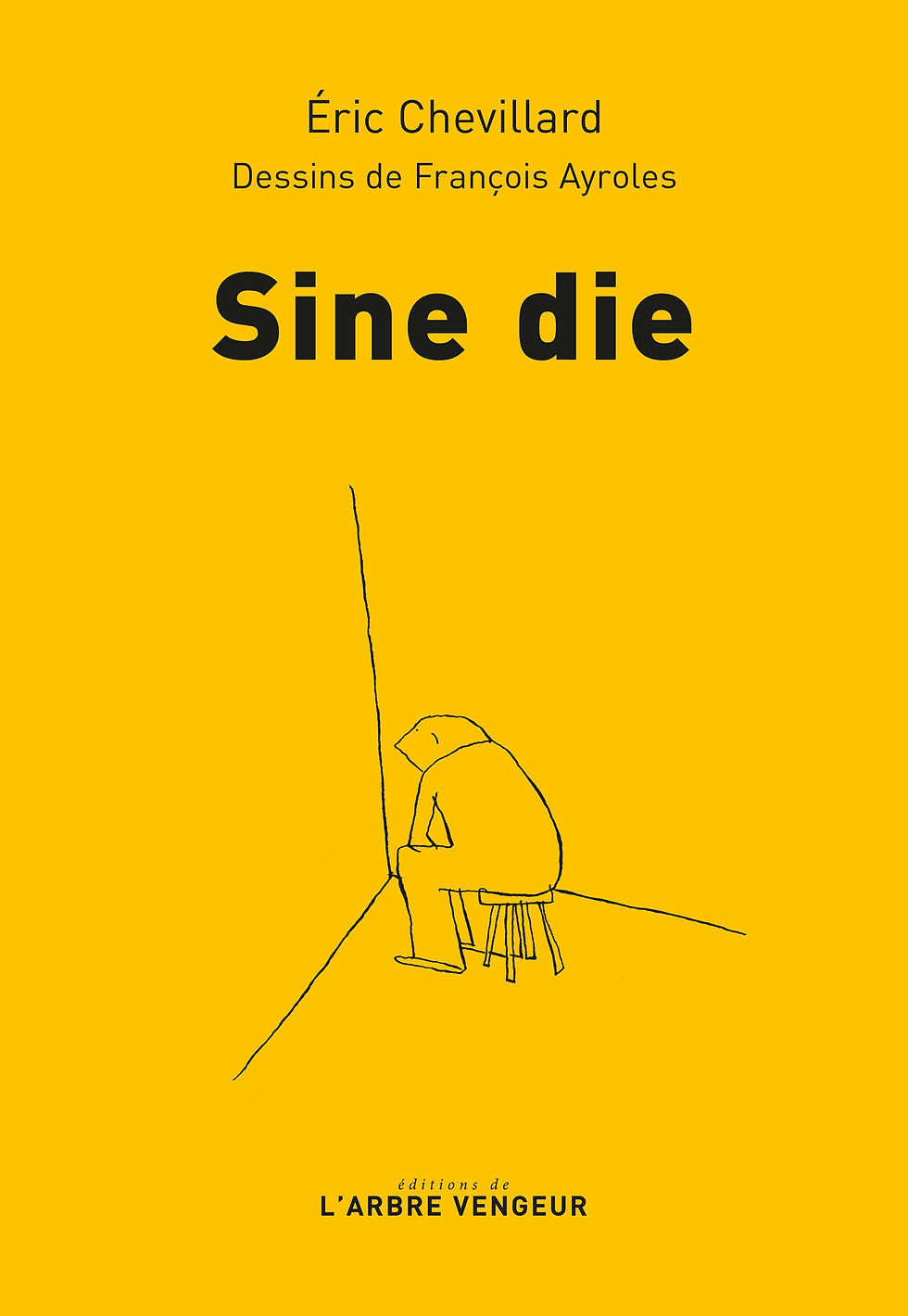
En quoi Chevillard est-il un contemporain capital ?
S’il ne fallait qu’un argument pour retenir cette œuvre, l’humour suffirait amplement. Rares sont les écrivains à avoir su faire entrer l’humour dans la littérature. Il s’agit de surcroît ici d’un humour bien particulier. Ce n’est pas le rire hénaurme de Rabelais, ce n’est pas l’humour grinçant de Céline, la moquerie à la Jonathan Swift, l’absurdité délectable de Lewis Caroll, l’humour politique de Georges Orwell, la verve enragée de Molière, les saillies spirituelles d'Alphonse Allais ou la pique ironique de Voltaire… Chevillard a inventé un humour varié, subtil, qui reste encore largement à étudier, entre l’autobiographie ludique et l’aphorisme cocasse.
Quelques exemples, entre le jeu de mots, l’image cocasse, la métaphore matérialisée et la critique implicite :
« Cette créature pourvue de cinq cents pattes me glaça le sang. Puis je m’avisai qu’il s’agissait d’un banal et inoffensif mille-pattes qui sautillait à cloche-pied. »
« Au terme d’une existence terne, réglée, ennuyeuse, il demanda à être incinéré. Au moins, expliqua-t-il, aurais-je brûlé ma vie par un bout. »
« Cette assemblée de têtes chenues… il doit s’agir d’une cérémonie d’obsèques. Ah non, pardon, c’est le public d’une rencontre littéraire. Ou sont-elles bien réunies là, en effet, sans méprise, pour pleurer une vieille amie disparue ? »
Dans une époque ultranarcissique, le texte de Chevillard se pose aussi comme une écriture de soi qui réussit l’exploit d’être pudique. Et cet univers qui semble léger repose sur des réflexions plus profondes qu’il n’y paraît au premier abord sur notre époque et ses travers : discrètement mais avec insistance, l’œuvre de Chevillard invite à s’interroger et à prolonger la lecture autour des places respectives de l’homme, des animaux et de la nature.
Le jury relève le soin tout particulier (et en même temps d’une grande désinvolture !) porté aux titres. Qu’ils soient livrés sous forme de monosyllabe (Scalps, 2004, Choir, 2010) ou, au contraire, d’une phrase entière (L’Autofictif prend un coach, L’Autofictif incendie Notre-Dame, L’Autofictif repousse du pied un blaireau mort, respectivement : 2012, 2020, 2021), les titres de Chevillard ne font jamais dans la facilité : ils jouent sur le suspense, le mystère, l’énigme, maniant tour à tour l’hypothèse incongrue (Si la main droite de l’écrivain était un crabe, 2011), la localisation à la fois précise et très incertaine (En territoire cheyenne, 2009, Dans la zone d’activité, 2007), le bestiaire insolite (La Nébuleuse du crabe, 1993, Chiens écrasés, 2011, Mais déjà les fourmis, 2021), la parodie littéraire (L’Autofictif au petit pois, 2015, L’Autofictif et les trois mousquetaires, 2019), sans être indifférents à l’allitération, mais sur un mode fantaisiste plus que lyrique (Mourir m’enrhume, 1987, Ronce-Rose, 2017, Détartre et désinfecte, 2017). Un titre comme Iguanes et Moines (2011) joue par exemple sur plusieurs de ces cordes à la fois. Certains titres intriguent, d’autres agacent, mais aucun ne laisse indifférent, entre le sourcil qui se lève et les bras qui tombent. Des personnages y passent et repassent, des célébrités y rodent, des animaux s’y ébattent : le jury fait le pari que ces titres donneront lieu un jour à une thèse de doctorat, tant ils sont exemplaires, dès l’entame des livres, du jeu de Chevillard avec les conventions narratives.
Enfin, il est à souligner que Chevillard est un des premiers – mais aussi des plus tenaces – à faire entrer l’écriture du blog dans la littérature (ou l’inverse). Dans son blog nommé « L’Autofictif », il écrit quotidiennement des billets et des fragments qui sont ensuite réunis annuellement en volume aux Éditions L’Arbre vengeur. Chevillard utilise ce support d'expression contemporain en lui donnant une tournure unique. Dans la lignée des Nouvelles en trois lignes de Félix Fénéon, il invente une forme en trois paragraphes, tenue depuis septembre 2007, qu’il faut saluer pour son caractère à la fois innovant et durable.
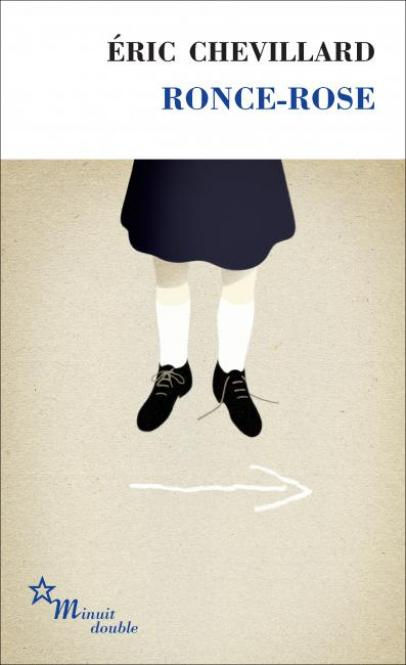
En conclusion
Les livres de Chevillard ont déjà été récompensés par des prix importants et on les voit apparaître de ci de là, comme des ludions, au fil des palmarès[3]. Et le jury du Prix Gide du contemporain capital a bien compris que l'auteur désire avant tout qu'on lui fiche la paix :
« Comme tout le monde, je marche en remuant les jambes, comme tout le monde, j'ai connu l'amertume et la douceur de l'amour, (...) comme tout le monde, je vais mourir – il ne manquerait plus que je sois un auteur grand public ! Pitié, non ! N'a-t-on pas compris ? C'est un peu de solitude enfin que je vais chercher là.»
Mais non. Cet auteur n'est décidément pas « comme tout le monde » et le jury estime que son œuvre n’est pas encore reconnue à sa juste valeur. Cette nouvelle langue, cet univers singulier, fantaisiste et réaliste, constitué par des esquives et des synecdoques plutôt que par des métaphores, et des trouvailles formelles qui semblent inépuisables, reste à découvrir et à partager plus largement.
Dernier livre paru : Chiens écrasés, Éditions Mexico, 2024.

Extraits
3 octobre
Si je choisis dans l’incendie de sauver la Joconde, ce tableau restera associé à la fin tragique d’un enfant brûlé vif et ne sera définitivement plus cette œuvre mystérieuse et captivante que nous aimions. Il nous semblera même percevoir de la cruauté dans le sourire autrefois si énigmatique de Mona Lisa.
Oui, mais si je sauve l’enfant dans l’incendie, il sera à jamais celui à cause de qui le plus grand chef-d’œuvre de l’histoire des hommes fut réduit en cendres et sa vie paraîtra toujours injustifiée en regard de ce sacrifice.
J’hésitais, j’hésitais, et pendant ce temps-là le feu progressait, il commençait à faire chaud et puisqu’il fallait opter, enfin je me décidai, je sautai par la fenêtre pour sauver mes fesses.
*
5 octobre
Ce fenêtrier me tendit son catalogue, avec un sourire commercial : — Je suis certain que vous trouverez votre affaire chez nous, me dit-il. Mais je hochai la tête en lisant le slogan de l’entreprise inscrit sur la couverture : « Bien plus qu’une fenêtre ». — Je ne crois pas, répondis-je… moi, il me faut une fenêtre, ni plus ni moins.
L'Autofictif repousse du pied un blaireau mort, Bordeaux, L’Arbre vengeur, 2021.
*
C’est un vrai lit de camp de broussard, toile rêche, écrue, tendue sur une structure de bois pliable, inutile de songer à dormir là-dessus mais on ne saurait en effet être mieux alité pour suer les poisons du palu, de la fièvre jaune et du béribéri.
Je l’ai installé dans la galerie des Espèces disparues, quitte à paraître d’emblée exagérément catastrophiste, mais cette longue salle accueille aussi les espèces menacées et je ne suis donc pas moins raisonnablement pessimiste que les conservateurs du Muséum qui ont jugé opportun de les exposer ensemble – celles qui ne sont plus et celles qui semblent condamnées –, peut-être pour n’avoir pas à déplacer ces fragiles spécimens quand ils passent d’un statut à l’autre.
Tant il est vrai que le vieillard qui tousse ne s’enrhumera pas davantage dans la chambre froide de la morgue.
Préparons-lui son lit là tout de suite.
Mais je ne suis pas ici pour dormir ni a fortiori pour mourir. Au milieu de ces créatures naturalisées, je me trouve plutôt en forme, plutôt alerte. Et même ingambe, mais ce mot ne dit plus très bien ce qu’il veut dire. Il a du plomb dans l’aile, des chevrotines dans la fesse. Peut-être n’est-ce pas un hasard qu’il me soit venu à l’esprit justement ici, dans la galerie des Espèces disparues, pour dire le contraire de ce qu’il voulait dire. Quand un mot disparaît, une ombre soudain éclipse un petit coin du monde, comme lorsque se ferme la paupière du dernier individu d’une espèce, la paupière de velours – ou serait-ce un pétale de myosotis ? – de l’hippotrague bleu, par exemple, ou la paupière d’écaille de la grande tortue de Rodrigues.
Une espèce s’éteint – un nuage s’arrête devant le soleil, une bourrasque souffle la bougie, tous les plombs sautent, ce livre ne sera correctement lu que dans l’édition en braille.
L’Arche Titanic, Paris, Stock, « Une nuit au musée », 2022.
*
19 mars
Coussins, couffins et confitures, ce ne doit pas être aussi terrible que ça, le confinement. Chacun chez soi, mais aux confins du monde. Même le sédentaire se sent dépaysé. Quelle aventure ! Citons Rimbaud, l’exergue de tous nos livres : « Assez vu. La vision s’est rencontrée à tous les airs. / Assez eu. Rumeurs des villes, le soir, et au soleil, et toujours. / Assez connu. Les arrêts de la vie. – Ô Rumeurs et Visions ! / Départ dans l’affection et le bruit neufs ! » (Départ)
On ne sort plus, quel voyage ! Il y a justement chez moi un couloir que je me promets depuis toujours de longer jusqu’au bout. L’heure est venue de ces expériences. Un bidet encombre la salle de bains, je vais avoir le temps de m’initier à cette pratique ancienne et révolue, retrouver les gestes simples de nos pères. Grimper aux rideaux, avez-vous déjà vraiment essayé ? Et vous cogner la tête contre les murs ? Il y a tant à faire dans une maison.
Dehors, rôde l’horrible virus hérissé d’antennes sensibles qui captent notre présence à plus d’un kilomètre – comme le squale la goutte de sang dans l’immensité de la mer – et de palpes gluants pour se suspendre à nos lèvres, comme un amoureux ardent. Des hordes de pangolins enragés se répandent dans les rues en toussant leurs poisons et, dès que le jour baisse, ce sont les chauves-souris qui fondent sur le passant pour se moucher dans son coude. Nous ne sommes plus en sécurité que chez nous.
Nous claquons la porte. Nous poussons devant elle le buffet du salon. Sur le buffet, nous empilons nos encyclopédies. Sur cette pile, nous asseyons nos enfants. Et, dans les mains de ces porteurs sains, nous déposons des peluches garnies de plomb. Le pavillon « Sam Suffit » est rebaptisé fort Alamo. « Home, sweet home » redevient notre fière devise. Nous la peignons en lettres d’or sur nos écus et les portières de nos automobiles encalminées.
Or, puisque nous avons pris l’habitude d’élire quand l’effroi nous visite un livre qui tout à la fois nous console et nous venge – Paris est une fête, Notre-Dame de Paris –, je suggère cette fois que nous ouvrions tous séance tenante et in situ le Voyage autour de ma chambre que Xavier de Maistre commença en 1790, lorsqu’il fut mis aux arrêts lui aussi : « Le plaisir que l’on trouve à voyager dans sa chambre est à l’abri de la jalousie inquiète des hommes ; il est indépendant de la fortune. »
Son voyage dura quarante-deux jours. Combien de jours durera le nôtre ?
À demain.
Sine die, chroniques du confinement, Bordeaux, L’Arbre vengeur, 2021.
[1] La taupe et l’édredon, Éric Chevillard et Denis Saint-Amand, « La taupe et l’édredon », Revue critique de fixxion française contemporaine [En ligne], 29 | 2024, mis en ligne le 15 décembre 2024, consulté le 18 juillet 2025. URL : http://journals.openedition.org/fixxion/14637 ; DOI : https://doi.org/10.4000/12xha
[2] Cette notice, publiée sur le site internet d’Éric Chevillard (Biographie - Éric Chevillard) est extraite du précieux Dictionnaire des écrivains contemporains de langue française par eux-mêmes (sous la direction de Jérôme Garcin), Paris, Éditions Mille et Une Nuits, 2004.
[3] Prix Fénéon : La Nébuleuse du crabe, Minuit, 1993, Prix Wepler : Le Vaillant petit tailleur, 2004, Prix Roger-Caillois : Démolir Nisard, 2006, Prix Virilo : Dino Egger, Minuit, 2011, Prix François-Billetdoux de la Scam : Le Désordre azerty, Minuit, 2014, et Prix Alexandre Vialatte pour l’ensemble de son œuvre, 2014.


